Bataille de Valmy
La bataille de Valmy est une victoire majeure pour la jeune République française. Elle arrête l’avance prussienne vers Paris et galvanise la Révolution.
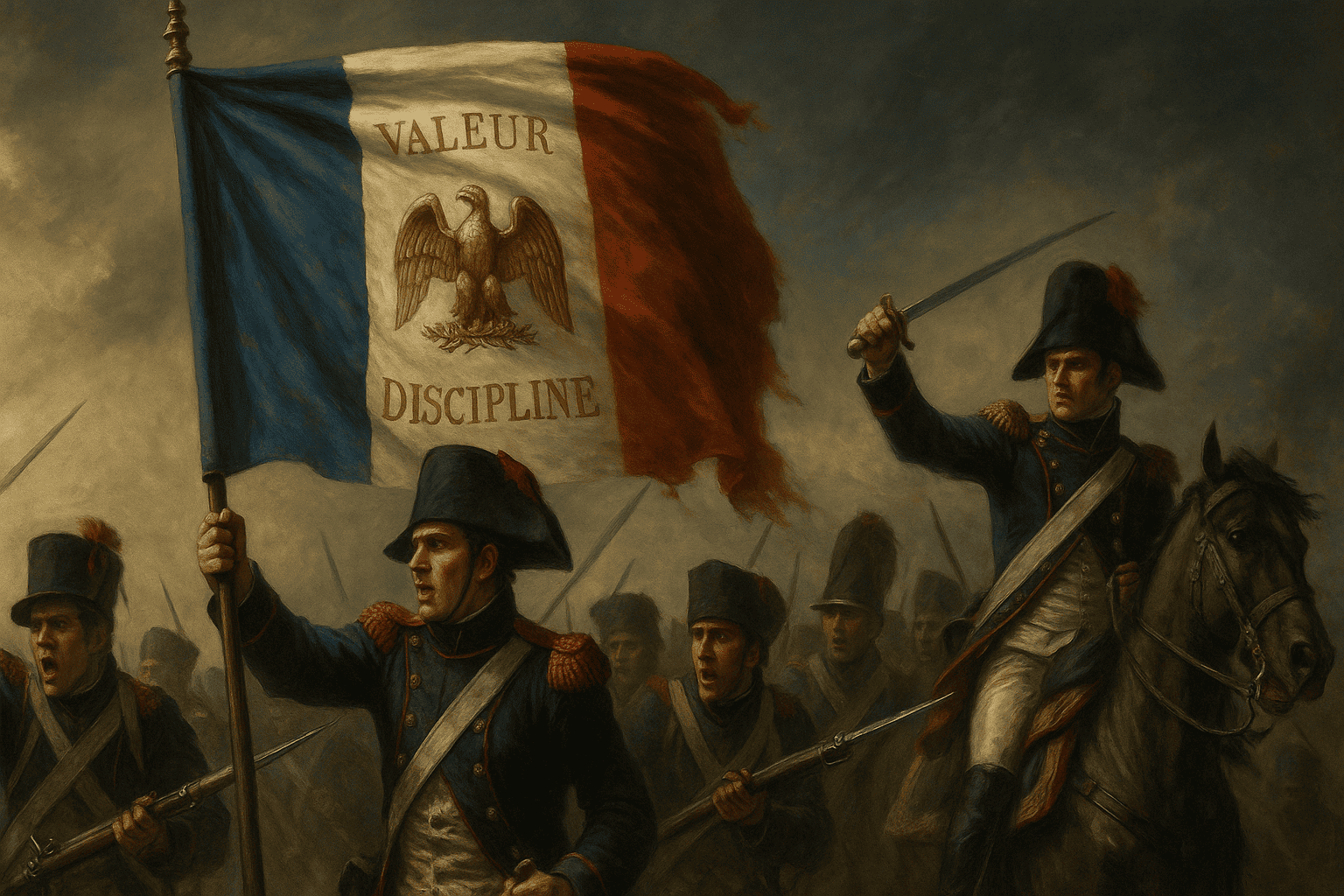
1789 – 1815
Époque marquée par la Révolution française et l'Empire de Napoléon, révolutionnant l’art militaire avec les batailles célèbres d'Austerlitz (1805), Iéna (1806) et Waterloo (1815).
La bataille de Valmy est une victoire majeure pour la jeune République française. Elle arrête l’avance prussienne vers Paris et galvanise la Révolution.
La bataille de Jemappes est une victoire importante des armées révolutionnaires françaises qui permet la conquête de la Belgique et marque une avancée majeure dans la guerre contre les monarchies coalisées.
La bataille d'Andernach est une victoire française importante qui repousse les forces prussiennes sur la rive est du Rhin, consolidant les gains territoriaux de la République.
La bataille de Neerwinden est une défaite française significative qui marque le recul des forces révolutionnaires en Belgique.
La première bataille de Wissembourg est un affrontement indécis entre les forces françaises révolutionnaires et les armées coalisées, qui ne réussit pas à débloquer la situation sur le front rhénan.
La bataille de Wissembourg est une victoire majeure des armées révolutionnaires françaises qui repoussent les forces coalisées hors d’Alsace et consolident leur contrôle sur la région.
La bataille de Hondschoote est une victoire française qui met fin au siège de Dunkerque et repousse les forces coalisées hors des Flandres.
Le siège de Valenciennes se solde par une défaite française, la ville tombant aux mains des forces coalisées après un siège prolongé.
La bataille de Wattignies est une victoire stratégique pour les forces révolutionnaires françaises qui permet de lever le siège de Maubeuge tenu par les troupes autrichiennes. Elle redonne confiance aux armées françaises et sécurise une position clé dans le Nord.
La bataille de Kaiserslautern est une victoire française clé qui stoppe l’avancée prussienne dans la région et sécurise les positions françaises le long du Rhin.
Le siège de Toulon est une victoire stratégique pour la République française, qui reprend la ville tenue par des royalistes soutenus par une coalition anglo-espagnole. C’est lors de ce siège que Napoléon Bonaparte se fait remarquer pour ses talents d’artilleur.
La bataille de Fleurus est une victoire décisive française qui assure le contrôle de la Belgique et ouvre la voie à la conquête des Pays-Bas autrichiens.
Le siège de Valenciennes est une victoire française importante qui permet de reprendre la ville aux forces coalisées et de consolider la position de la République dans le nord.
La bataille de Bâle est une victoire française importante qui assure la domination de la République sur une partie du Rhin supérieur et ouvre la voie à l’occupation de la Suisse.
En 1795, plusieurs escarmouches et engagements ont lieu dans la région de Höchstädt entre les armées françaises et autrichiennes. Ces affrontements n'aboutissent à aucune victoire décisive et se soldent par des retraits mutuels sans changement territorial significatif.
La bataille de Biberach est une victoire française qui renforce la position de Moreau dans le sud de l'Allemagne en repoussant les forces autrichiennes dirigées par Latour.
Première grande victoire de Napoléon en Italie, la bataille de Montenotte sépare les forces austro-sardes en deux, compromettant leur coordination et ouvrant la voie à la domination française dans la région.
La bataille de Millesimo consolide la victoire de Montenotte en harcelant les troupes en retraite, perturbant davantage la cohésion des forces austro-sardes.
Victoire qui complète la fragmentation des forces coalisées, donnant aux Français le contrôle d’une position stratégique importante sur la route vers le sud.
Victoire française qui force le royaume de Sardaigne à demander un armistice, facilitant la conquête du Piémont.
Victoire majeure qui ouvre la voie à la prise de Milan, consolidant la campagne italienne de Napoléon.
Victoire française qui neutralise une tentative autrichienne de lever le siège de Mantoue.
Victoire qui repousse les Autrichiens vers l’est, consolidant le contrôle français en Vénétie.
Engagement tactique qui ne modifie pas substantiellement la situation stratégique dans la région.
Victoire française grâce à une offensive audacieuse qui prend le contrôle du pont d’Arcole, stoppant l’avance autrichienne.
Victoire décisive mettant fin à l’offensive autrichienne et assurant la domination française en Italie du Nord.
Victoire stratégique de Hoche qui force les Autrichiens à reculer, consolidant la position française le long du Rhin.
Victoire décisive de Napoléon qui brise la puissance militaire des Mamelouks en Égypte, ouvrant la voie à la conquête française du pays.
Défaite navale majeure pour la France où la flotte de Brueys est anéantie par la marine britannique commandée par Nelson, isolant l’armée française en Égypte.
Défaite française lourde qui force Jourdan à battre en retraite, affaiblissant la position française dans le sud-ouest de l’Allemagne.
Victoire française qui défend avec succès la position d’Alexandrie contre une offensive ottomane, consolidant la présence française en Égypte malgré l’isolement maritime.
Le 15 août 1799, la bataille de Novi oppose l’armée française du général Joubert à une coalition austro-russe dirigée par le maréchal Souvorov et le général Kray. Dès les premières heures, Joubert est mortellement touché, privant les Français d’un commandement centralisé, ce qui déstabilise gravement leurs lignes. Les troupes françaises, déjà éprouvées par les précédents combats et en infériorité numérique, affrontent néanmoins avec acharnement les attaques répétées des coalisés. La journée est marquée par des assauts frontaux et des contre-attaques locales, où l’armée française fait preuve d’une résistance remarquable mais insuffisante. La bataille, l’une des plus sanglantes de la campagne d’Italie, se conclut par une défaite française majeure et par un retrait précipité vers les Apennins.
Victoire française majeure sous Masséna qui force la coalition à se retirer de Suisse, assurant un contrôle stratégique de la région.
Victoire française décisive sous Kléber qui repousse une grande armée ottomane, sécurisant la domination française sur le delta du Nil.
Victoire française importante qui permet de repousser les forces autrichiennes et de sécuriser la progression française en Allemagne du Sud.
La bataille de Marengo est une victoire décisive de Napoléon Bonaparte qui assure le contrôle de l’Italie du Nord. Après un début difficile, l’armée française, grâce à une contre-attaque menée par Desaix, renverse la situation et inflige une lourde défaite aux Autrichiens.
La bataille d'Elchingen, souvent appelée bataille de Höchstädt, est une victoire décisive des forces françaises sous le commandement du général Ney, qui permet la rupture des lignes autrichiennes et la reprise de l'offensive en Allemagne du Sud.
Victoire décisive de Moreau lors de la bataille de Hohenlinden, qui inflige une lourde défaite aux Autrichiens et permet la poursuite de l’offensive française en Allemagne.
La bataille de Pozzolo est une victoire française importante qui permet de repousser les forces autrichiennes au-delà du Mincio et consolider la domination française en Lombardie.
L'expédition française en Hollande vise à repousser les forces coalisées britanniques et russes qui occupaient la République batave. Moreau réussit à restaurer le contrôle français sur la région.
Le siège du Caire se termine par la capitulation des forces françaises face aux troupes britanniques, mettant fin à la campagne française en Égypte.
Le siège d’Alexandrie se termine par la capitulation des forces françaises face aux Britanniques, mettant fin à la présence française en Égypte.
Défaite navale française près d’Alexandrie, réduisant significativement la capacité maritime française en Méditerranée et coupant définitivement les liens entre la France et ses troupes en Égypte.
En 1802, la France lance une grande expédition militaire dirigée par le général Leclerc pour rétablir le contrôle sur sa colonie de Saint-Domingue, gravement secouée par la rébellion des esclaves. Malgré des victoires tactiques initiales, la campagne se heurte à une résistance acharnée des insurgés et à des pertes massives dues aux combats et maladies tropicales.
Le fort Crête-à-Pierrot, tenu par les insurgés haïtiens, est assiégé par les troupes françaises dans une bataille prolongée. Malgré une résistance féroce des insurgés, les Français prennent finalement le fort après plusieurs semaines de combats.
Le siège de la ville portuaire de Saint-Marc est mené par les forces françaises cherchant à reprendre une position stratégique tenue par les insurgés. Après plusieurs semaines de combat, les Français réussissent à s’emparer de la ville.
La bataille de Vertières est le dernier grand affrontement de la guerre d'indépendance haïtienne. Les forces françaises, affaiblies par les combats prolongés et les maladies, sont défaites par l'armée insurgée haïtienne menée par Dessalines. Cette défaite entraîne la reddition finale des troupes françaises et marque la fin de la présence coloniale française à Saint-Domingue.
Après la rupture de la paix d'Amiens, les Britanniques reprennent l'île stratégique de Saint-Lucie dans les Antilles, reprenant le contrôle des territoires colonisés pendant la courte paix.
Le siège du Cap-Français est un long siège qui affaiblit progressivement les forces françaises dans leur principal bastion en Saint-Domingue. La résistance haïtienne, combinée aux conditions difficiles, mène à la reddition finale après la bataille de Vertières.
La bataille de Wertingen est le premier affrontement de la campagne d'Ulm. La cavalerie française, dirigée par Murat, balaie l’avant-garde autrichienne dans une attaque rapide et violente. Lannes soutient l’offensive avec de l’infanterie.
Lannes reçoit l'ordre de s'emparer des ponts sur le Danube à Günzburg pour couper la retraite des Autrichiens vers l'est. Il lance plusieurs assauts contre les défenses autrichiennes qui protègent les passages stratégiques.
La division Dupont, isolée, se heurte à une force autrichienne écrasante près d’Ulm. Malgré son infériorité numérique, elle tient sa position pendant plusieurs heures, infligeant de lourdes pertes et empêchant toute percée stratégique.
La bataille d’Elchingen est un affrontement crucial dans le resserrement de l’étau autour d’Ulm. Ney lance une attaque vigoureuse contre les forces autrichiennes retranchées sur les hauteurs d’Elchingen, les forçant à battre en retraite dans le désordre.
La capitulation d’Ulm met un terme à l’encerclement stratégique orchestré par Napoléon. Le général autrichien Karl Mack se rend avec près de 27 000 hommes sans véritable bataille, pris au piège par la rapidité de manœuvre de la Grande Armée.
Trafalgar est la plus célèbre bataille navale des guerres napoléoniennes. La flotte franco-espagnole tente de briser le blocus britannique, mais est interceptée et détruite par Nelson, dont la tactique audacieuse conduit à une victoire écrasante malgré sa mort au combat.
La bataille de Caldiero oppose les troupes de Masséna à celles de l’archiduc Charles dans des conditions météorologiques difficiles. Malgré plusieurs tentatives, les Français ne parviennent pas à percer les lignes autrichiennes.
La division Gazan, isolée dans une gorge du Danube, est encerclée et attaquée de tous côtés par une force austro-russe bien supérieure. Mortier envoie des renforts pour éviter l’anéantissement. Les combats sont sanglants et intenses, mais les Français parviennent à se dégager.
Dans cette action d’arrière-garde, le général russe Bagration retarde habilement l’avance française pour permettre au gros de l’armée austro-russe de se replier vers Brünn et rejoindre Koutouzov. Murat tombe dans le piège diplomatique des Russes, acceptant un faux armistice pour gagner du temps.
La bataille d’Austerlitz, dite « des Trois Empereurs », marque l’apogée de la stratégie napoléonienne. Face à une armée alliée supérieure en nombre, Napoléon utilise la ruse, la préparation minutieuse du terrain et la mobilité de ses troupes pour transformer une position apparemment défavorable en une victoire écrasante. Il choisit délibérément de placer son armée sur le plateau de Pratzen, qu’il fait ensuite évacuer afin d’attirer l’ennemi à y concentrer ses forces. Convaincus que le flanc droit français est affaibli, les Austro-Russes y lancent l’essentiel de leurs troupes. Cette manœuvre affaiblit dangereusement leur centre, qu’ils estiment hors d’atteinte. Napoléon attend que l’ennemi s’engage pleinement dans cette erreur avant de donner l’ordre au corps de Soult, dissimulé dans la brume, de monter à l’assaut du plateau. La percée du centre coupe littéralement l’armée alliée en deux, semant la panique et rendant toute coordination impossible. Sur les ailes, Davout et Lannes résistent ou progressent selon le plan, tandis que la cavalerie de Murat et la Garde impériale exploitent l’effondrement du dispositif ennemi pour capturer des milliers de prisonniers. La déroute est totale : de nombreux soldats austro-russes se noient en tentant de fuir à travers les étangs gelés de Satschan, sous le feu de l’artillerie française. Austerlitz est non seulement un chef-d’œuvre tactique, mais aussi un tournant politique pour l’Europe, la victoire plaçant Napoléon au sommet de sa gloire et bouleversant l’équilibre continental.
La bataille de Saalfeld voit la rencontre entre l’avant-garde française de Lannes et un corps prussien commandé par le jeune prince Louis-Ferdinand. Malgré sa bravoure, ce dernier meurt au combat, et ses troupes sont défaites par des manœuvres habiles des troupes françaises.
La bataille de Iéna voit Napoléon écraser l'aile gauche de l'armée prussienne. Malgré un brouillard matinal et des informations incomplètes, l’Empereur manœuvre habilement ses corps d’armée pour submerger les positions ennemies. L’arrivée en renfort du corps de Davout à Auerstaedt le même jour parachève une déroute générale.
Le même jour que Napoléon à Iéna, Davout se retrouve face à l’essentiel de l’armée prussienne. Malgré une infériorité numérique de 1 contre 2, il résiste toute la journée grâce à la discipline exceptionnelle de ses troupes. Le général Brunswick est mortellement blessé, la chaîne de commandement prussienne s’effondre, et Davout transforme une position défensive en victoire éclatante.
Trois jours après Iéna, Bernadotte intercepte à Halle une importante division prussienne en retraite. Il lance une attaque brutale contre leurs positions retranchées, prenant la ville de vive force, coupant les ponts et semant le chaos dans les rangs ennemis.
La colonne prussienne du prince Hohenlohe, en retraite après Iéna, est interceptée près de Prenzlau par la cavalerie de Murat. Une brève escarmouche dégénère en encerclement, et Murat force Hohenlohe à capituler en exagérant la force française. La ruse, la vitesse et la pression tactique triomphent.
Cherchant à échapper à l’encerclement, Blücher tente de se réfugier à Lübeck, ville libre et neutre. Les Français forcent l’entrée de la ville, malgré les protestations des autorités, et livrent bataille dans les rues. Les combats sont intenses et se terminent par la capitulation prussienne.
Après un court siège, la puissante forteresse de Magdebourg, l’une des plus importantes de Prusse, capitule sans offrir de réelle résistance. Ney, encerclant la ville et bombardant ses abords, convainc le commandant prussien de se rendre.
Dans une offensive hivernale éprouvante, les forces françaises engagent l’arrière-garde russe à Gołymin. Les combats sont confus, rendus difficiles par la neige, la boue et la tombée de la nuit. Les Russes résistent fermement, puis parviennent à se replier en bon ordre.
Dans des conditions météorologiques extrêmes, Lannes affronte une armée russe supérieure en nombre à Pułtusk. Bien qu’attaqué violemment, Bennigsen refuse de reculer immédiatement et soutient le combat toute la journée. À la tombée de la nuit, les Russes se retirent en bon ordre, mais les deux camps revendiquent la victoire.
Dans une phase de redéploiement hivernal, Ney est surpris par une offensive russe près de Mohrungen. Ses troupes, en infériorité numérique, résistent avec acharnement et empêchent les Russes de pénétrer plus profondément dans la zone française. Après de violents combats, les Russes se replient.
La cavalerie française de Murat engage les avant-gardes russes dans un terrain glacé et difficile. Les combats sont violents mais confus, se terminant sans vainqueur clair. Cette bataille prépare le terrain pour la confrontation décisive à Eylau deux jours plus tard.
Eylau est l’une des batailles les plus violentes de l’ère napoléonienne. Sous une tempête de neige, les Français attaquent les lignes russes autour de la ville d’Eylau. Le champ de bataille est chaotique, la visibilité nulle. Murat mène une charge de cavalerie de plus de 10 000 hommes pour stopper l’avance ennemie. À la fin de la journée, les deux camps restent sur le terrain, exsangues. Napoléon revendique la victoire, mais le résultat est militairement indécis.
La division Verdier, isolée à Ostrołęka, est attaquée par une force russe bien supérieure. Verdier défend habilement ses positions, repousse plusieurs assauts et conserve le contrôle de la ville après une journée de combats acharnés.
La bataille de Heilsberg oppose les forces françaises aux Russes solidement retranchés sur les hauteurs derrière la rivière Alle. L’attaque française, mal coordonnée, se heurte à une défense acharnée. Les pertes sont lourdes des deux côtés, et les Français ne parviennent pas à percer.
La bataille de Friedland oppose les forces françaises de Napoléon à l’armée russe de Bennigsen, qui a imprudemment engagé le combat avec la rivière Alle dans son dos. Après une défense tenace menée par Lannes le matin, Napoléon arrive avec le gros de ses forces, déclenche une attaque massive sur le flanc gauche russe et écrase l’armée ennemie. La victoire est totale, scellant la fin de la campagne.
Les deux affrontements d’El Bruc voient des colonnes françaises attaquées dans les montagnes catalanes par des milices locales. Mal préparées au terrain, les forces de Schwartz puis de Chabran sont repoussées par une défense tenace, renforcée par l’effet de surprise et le soutien populaire.
La bataille de Medina de Rioseco voit les forces françaises de Bessières attaquer une armée espagnole divisée. Profitant du manque de coordination entre les généraux Blake et Cuesta, Bessières lance une attaque décisive sur le centre et détruit l’union des forces ennemies. C’est l’un des rares succès français du début de la guerre d’Espagne.
La bataille de Bailén oppose les troupes françaises du général Dupont, isolées dans la vallée du Guadalquivir, aux armées espagnoles de Castaños et Reding. Après plusieurs jours d’escarmouches, les Français tentent de percer, mais sont pris en tenaille. Accablés par la chaleur, le manque de vivres et l’encerclement, Dupont capitule avec toute son armée.
Loison marche vers Lisbonne depuis l’intérieur du Portugal pour soutenir les forces d’occupation. À Évora, il rencontre une résistance formée de milices locales et de volontaires espagnols. Après une courte bataille, les Français balaient les positions ennemies et prennent la ville, qui est ensuite pillée par les troupes.
Le général Delaborde, en infériorité numérique, tente de ralentir l’avance britannique vers Lisbonne. Il se positionne sur les hauteurs de Roliça. Wellesley tente d’abord un mouvement d’encerclement, puis une attaque frontale. Malgré une résistance tenace, les Français sont repoussés mais se retirent en bon ordre.
Junot tente une attaque frontale contre les positions fortifiées de Wellesley autour de Vimeiro. Malgré plusieurs assauts déterminés, les Français échouent à percer. La supériorité défensive britannique, l’artillerie bien positionnée, et l’utilisation du terrain empêchent toute avancée française. Junot est contraint de battre en retraite.
Blake, mal positionné sur les hauteurs de Zornoza, est attaqué par Lefebvre avec une partie du IVᵉ corps. Les Français prennent l’avantage dès le début grâce à leur artillerie et leur discipline supérieure. Blake parvient à se retirer mais subit de lourdes pertes.
Alors qu’une division du maréchal Victor progresse isolée à l’avant, Blake parvient à la surprendre avec une attaque en force. Les Français sont momentanément battus et contraints de se replier. Il s’agit d’un rare succès espagnol pendant la campagne de novembre.
La bataille de Gamonal oppose l’avant-garde française de Soult à une force espagnole inférieure commandée par Belveder. Les Espagnols, inexpérimentés et mal positionnés en plaine, sont balayés par l’infanterie française soutenue par une puissante charge de cavalerie. La route de Burgos est ouverte.
Après la surprise de Valmaseda, Victor poursuit Blake et le rattrape à Espinosa. Le 10 novembre, les Espagnols résistent aux premières attaques, mais le lendemain, Victor concentre ses forces, brise le centre espagnol et disperse l’armée. C’est une victoire complète qui élimine temporairement la menace dans le nord.
La bataille de Tudela oppose une armée espagnole mal coordonnée à une force française supérieure en organisation. Lannes attaque le centre et la droite espagnole, rompant leur ligne, tandis que Moncey poursuit l’effort sur l’aile gauche. L’armée espagnole est disloquée et en fuite avant la tombée de la nuit.
Pour ouvrir la route vers Madrid, Napoléon fait attaquer les redoutes espagnoles défendant le col de Somosierra. Après plusieurs assauts d’infanterie infructueux, il ordonne une charge audacieuse des chasseurs polonais de la Garde. Ces derniers percent les lignes ennemies, capturent les canons et forcent les Espagnols à la retraite. La route vers la capitale est dégagée.
Saint-Cyr, marchant depuis Gérone pour secourir Barcelone assiégée, affronte une armée espagnole inférieure en nombre mais solidement positionnée à Cardedeu. Il concentre ses forces pour une percée frontale rapide, qui rompt les lignes espagnoles. L’armée de Vives se débande et permet à Saint-Cyr de débloquer la ville peu après.
Après sa victoire à Cardedeu, Saint-Cyr poursuit l’offensive et attaque les forces combinées de Vives et Reding retranchées à Molins de Rei, en périphérie de Barcelone. L'assaut frontal coordonné, soutenu par l’artillerie, rompt les lignes espagnoles. L’armée ennemie se débande, et Barcelone est définitivement libérée du siège.
Dans le contexte de la retraite britannique vers La Corogne, les chasseurs de la Garde de Lefebvre-Desnouettes franchissent le fleuve Esla gelé pour tenter une attaque surprise sur l’arrière-garde anglaise. Mais les hussards britanniques réagissent rapidement, contre-chargent, et infligent une défaite aux Français. Lefebvre est capturé.
En poursuivant les forces britanniques en retraite, la cavalerie française atteint le pont de Cacabelos défendu par l’arrière-garde anglaise. Une attaque est lancée sans coordination avec l’infanterie française. Les Britanniques, bien postés, infligent des pertes et tuent le général Colbert d’un tir de tireur d’élite. Les Français reculent en attendant les renforts.
Victor attaque les forces espagnoles retranchées près du monastère d’Uclès. L’assaut bien coordonné brise la ligne ennemie, et la cavalerie française exploite la percée pour encercler les fuyards. La déroute est complète, et Venegas échappe de peu à la capture.
Acculée à la mer après une longue retraite, l’armée britannique défend la ville portuaire de La Corogne en attendant l’évacuation par mer. Soult attaque le 16 janvier, espérant empêcher leur fuite. Les Britanniques tiennent bon et résistent aux assauts français, réussissant à embarquer la majorité de leurs troupes durant la nuit. Moore est tué lors des combats.
Suchet affronte l’armée valencienne près de Castellón dans une bataille décisive pour sécuriser le flanc est de l’Espagne. Bien que légèrement inférieurs en nombre, les Français engagent une attaque méthodique et enfoncent le centre espagnol. La cavalerie française poursuit les fuyards et achève la victoire.
Suchet, voulant sécuriser la province de Tarragone, intercepte l’armée de Reding près de Valls. Après une reconnaissance prudente, il déclenche une attaque combinée au centre et sur les flancs. La cavalerie française, conduite avec habileté, exécute une manœuvre tournante qui piège les Espagnols. Reding est blessé mortellement dans la déroute.
Malgré l’infériorité numérique, Victor engage une manœuvre décisive contre l’armée de Cuesta disposée sur une large ligne étendue. Après avoir contenu les attaques espagnoles sur ses ailes, il lance une contre-offensive centrale appuyée par l’artillerie et la cavalerie. L’armée espagnole est totalement mise en déroute.
Wellesley mène une attaque surprise audacieuse sur Porto, traversant le Douro avec une force légère avant que Soult ne puisse réagir. Pris de vitesse, le maréchal français tente de rassembler ses troupes, mais le pont est coupé et les forces anglaises avancent rapidement dans la ville. La retraite devient inévitable.
La colonne française du général Schwartz, envoyée depuis Barcelone pour sécuriser la route vers Lérida, est stoppée dans le col d’El Bruc par des milices catalanes déterminées. Ces dernières, appuyées par des troupes régulières, utilisent les hauteurs et des embuscades coordonnées pour bloquer l’avance française. Après plusieurs tentatives de percée, Schwartz bat en retraite vers Barcelone.
La bataille de Wagram fut l’un des plus grands affrontements des guerres napoléoniennes, opposant les forces de Napoléon Ier à l’armée autrichienne commandée par l’archiduc Charles. Après avoir subi un revers à Aspern-Essling, Napoléon passe à nouveau le Danube début juillet 1809 à l’aide d’un vaste pont de bateaux construit en secret. Le 5 juillet, l’armée française est attaquée alors qu’elle est encore en déploiement, mais résiste aux assauts. Le lendemain, Napoléon organise une contre-offensive décisive, appuyée par une concentration massive d’artillerie au centre (la « grande batterie ») et une attaque puissante sur l’aile droite menée par le maréchal Davout. L’archiduc Charles, incapable de percer les lignes françaises ni de contenir leurs attaques coordonnées, ordonne la retraite dans la soirée du 6 juillet. Cette victoire permet à Napoléon d’imposer des conditions sévères à l’Autriche.
Les forces françaises de Joseph Bonaparte et du maréchal Victor attaquent les positions retranchées anglo-espagnoles autour de Talavera. La bataille est sanglante et acharnée, avec des assauts répétés contre les hauteurs tenues par les troupes de Wellington. Après deux jours de combat, les Français échouent à percer les lignes britanniques. Cependant, les alliés ne peuvent exploiter leur victoire en raison de la fatigue, des pertes et de l’arrivée d’une nouvelle armée française sur leurs arrières.
Les forces espagnoles de Venegas, tentant de marcher sur Madrid après la bataille de Talavera, sont interceptées à Almonacid par le général Sébastiani. Malgré leur supériorité numérique et une position défensive sur les hauteurs, les Espagnols sont repoussés après une série d’assauts coordonnés par l’infanterie et l’artillerie française. Leur ligne cède dans l’après-midi, et une retraite désorganisée s’ensuit.
Les Britanniques lancent un raid amphibie sur le port de Saint-Paul pour capturer la goélette corsaire française Caroline, très active dans l’océan Indien. Le gouverneur Des Bruslys, miné par la pression, se suicide la veille. Le colonel Saint-Michel organise une défense avec des miliciens et quelques pièces d’artillerie côtière, mais les Britanniques parviennent à débarquer, capturer le fortin, désarmer les batteries et incendier le port. La Caroline est saisie.
L’armée espagnole du duc del Parque occupe les hauteurs de Tamames et repousse frontalement l’attaque du général Marchand. Malgré plusieurs assauts, les troupes françaises, en infériorité numérique et mal coordonnées, ne parviennent pas à briser la ligne espagnole. La bataille marque l’un des rares succès tactiques espagnols en 1809.
Malgré leur infériorité numérique, Soult et Sébastiani affrontent l’armée espagnole d’Aréizaga près d’Ocaña. Grâce à une puissante attaque d’artillerie, une manœuvre de cavalerie sur l’aile droite et une infanterie expérimentée, les Français infligent une déroute totale aux Espagnols. L’armée de La Mancha est détruite.
Profitant du retrait précipité des troupes espagnoles du duc del Parque après Tamames, le général Kellermann engage une poursuite rapide. L’arrière-garde espagnole, surprise près du pont d’Alba de Tormes, est attaquée par la cavalerie française avant que l’armée entière ne puisse traverser la rivière. Les formations ennemies sont rompues et l’artillerie capturée.
La bataille de Grand Port est la seule victoire navale française majeure des guerres napoléoniennes après Trafalgar. Les frégates françaises de Duperré et Bouvet, aidées de batteries côtières, attirent les navires britanniques dans un lagon étroit. La flotte ennemie s’embourbe sur les récifs. Les Français détruisent deux navires et en capturent deux autres. C’est un revers retentissant pour la Royal Navy.
Masséna tente de percer la ligne défensive anglo-portugaise retranchée sur les hauteurs de Bussaco. L’assaut frontal mené par Reynier et Ney échoue face à une défense bien organisée et une artillerie alliée bien positionnée. Malgré sa supériorité numérique, l’armée française subit une défaite coûteuse et tactique.
La bataille de Barrosa voit les troupes françaises du général Victor tenter d’intercepter une tentative de sortie anglo-espagnole de Cadix. Bien que les Espagnols hésitent, les Britanniques de Graham montent une attaque énergique sur les hauteurs de Barrosa. Après un combat acharné, les Français sont repoussés, mais conservent leurs positions stratégiques. La bataille est considérée comme indécise, voire tactiquement favorable aux Alliés.
La bataille de Sabugal se déroule lors de la retraite de Masséna du Portugal. Le général Reynier, à l’arrière-garde, est attaqué de manière inattendue par une brigade britannique ayant franchi la rivière sous la brume. Malgré une résistance initiale, ses troupes sont mises en difficulté et doivent battre en retraite en désordre.
La bataille oppose Masséna, qui tente de dégager la garnison française assiégée à Almeida, à Wellington, solidement retranché à Fuentes de Oñoro. Après deux jours d’escarmouches, Masséna lance une attaque massive le 5 mai. Malgré un succès initial sur le flanc droit britannique, la résistance alliée tient bon. L’armée française se retire sans briser le blocus.
Soult tente de lever le siège de Badajoz en attaquant l’armée alliée à Albuera. L’assaut frontal français, dirigé par Godinot puis Girard, est initialement couronné de succès. Mais une contre-attaque acharnée de l’infanterie britannique et la ténacité des troupes espagnoles brisent l’élan français. Les deux camps subissent de lourdes pertes, sans victoire décisive.
La bataille de Zújar oppose la cavalerie française commandée par Latour-Maubourg à une force espagnole isolée tentant d’interrompre les communications françaises dans le sud-ouest de l’Espagne. Grâce à une manœuvre habile de contournement, la cavalerie française disperse les forces ennemies et capture un grand nombre de prisonniers.
Le général Hugo intercepte une force mobile de guérilla commandée par 'El Empecinado' dans la région montagneuse de Cuenca. Grâce à un mouvement de flanc et à l’effet de surprise, les troupes françaises parviennent à encercler partiellement les Espagnols et à infliger de lourdes pertes.
Suchet affronte l'armée espagnole de Blake, venue tenter de dégager la ville assiégée de Sagonte. Grâce à une attaque déterminée sur le centre ennemi, les troupes françaises enfoncent les lignes espagnoles et obtiennent une victoire décisive, ouvrant la route vers Valence.
Suchet lance une manœuvre audacieuse pour prendre Valence en encerclant les forces de Blake. Après des combats intenses autour de Mislata et de la rivière Turia, l’armée espagnole est prise au piège. Blake tente une percée mais échoue, et doit capituler avec une grande partie de ses troupes.
Wellington lance un assaut rapide contre Ciudad Rodrigo, tenue par une petite garnison française. Après un bombardement intense de plusieurs jours, les troupes anglo-portugaises percent les murs de la ville et lancent un assaut nocturne. La garnison française est submergée malgré une défense courageuse.
Après un siège éprouvant et plusieurs jours de bombardement intensif, les forces anglo-portugaises lancent un assaut nocturne contre les fortifications de Badajoz. Malgré une défense acharnée des Français, les Alliés parviennent à s’emparer de la ville après de violents combats de rue.
La bataille de Salamanque voit l’armée du Portugal, dirigée par Marmont, surprise et battue par une attaque habile de Wellington. Une fausse manœuvre de Marmont expose son flanc gauche, que les Alliés exploitent avec une attaque décisive qui brise les lignes françaises.
Napoléon attaque la ville fortifiée de Smolensk pour y fixer l’armée russe et forcer une bataille décisive. Malgré des combats intenses et des bombardements dévastateurs, les Russes finissent par abandonner la ville dans la nuit, permettant aux Français de s’en emparer.
La bataille de la Moskova, dite bataille de Borodino, est l’affrontement le plus sanglant des guerres napoléoniennes. Napoléon tente de briser l’armée russe avant d’atteindre Moscou. Après une journée d’assauts frontaux meurtriers sur les redoutes russes, les Français parviennent à percer le centre ennemi, sans pour autant détruire l’armée russe, qui se replie dans l’ordre.
Alors que Murat observait les Russes campés à Taroutino dans le cadre du repli général français, ceux-ci lancent une attaque surprise à l’aube. L’avant-garde française est surprise, subit de lourdes pertes, et bat en retraite en désordre. Napoléon perd l’initiative stratégique.
Dans une tentative de retraite par le sud, Napoléon fait avancer les troupes d’Eugène vers Kalouga. À Maloyaroslavets, elles affrontent les forces russes dans un combat urbain acharné. La ville change de mains plusieurs fois. Bien que les Français prennent l’avantage, Napoléon choisit de se replier par la route déjà ravagée de Smolensk.
Surpris par une attaque russe alors qu’il menait l’arrière-garde de la retraite de Moscou, Murat est forcé au combat à Vinkovo. Ses forces sont débordées par la supériorité numérique de l’ennemi et doivent abandonner le terrain, rompant ainsi la couverture du repli.
Durant la retraite de Russie, plusieurs corps de la Grande Armée sont attaqués séparément par les Russes près de Krasnoï. Napoléon parvient à dégager Eugène et Davout, mais le corps de Ney est isolé et durement frappé. Il parvient néanmoins à rejoindre l’armée après une marche légendaire.
Dans une tentative désespérée de traverser la Bérézina pour échapper à l’encerclement, Napoléon fait ériger deux ponts sous le feu russe. Grâce à une diversion réussie, les troupes françaises parviennent à franchir la rivière au prix de lourdes pertes. Le terme 'c’est la Bérézina' naît de cette retraite sanglante.
Lützen est la première grande bataille de la campagne d’Allemagne. Surpris par une attaque des troupes russo-prussiennes sur son flanc, Napoléon réagit avec célérité, rassemble ses forces, et lance une contre-attaque massive. Les Alliés se retirent en ordre mais concèdent le champ de bataille.
Napoléon lance une attaque massive sur les forces russo-prussiennes retranchées à Bautzen. Malgré des combats violents et une supériorité numérique, l’armée alliée parvient à battre en retraite. La coordination imparfaite entre Ney et Napoléon empêche l’encerclement attendu.
Wellington lance une attaque coordonnée sur quatre axes contre les positions françaises à Vitoria. Débordés sur leurs flancs et au centre, les Français battent en retraite en désordre. La déroute est aggravée par la perte du trésor et des bagages de Joseph Bonaparte.
Les Alliés lancent une attaque sur Dresde en pensant affronter une force française inférieure. Mais Napoléon arrive à temps avec des renforts et organise une contre-offensive efficace, en exploitant le terrain détrempé pour piéger l’ennemi. Les Alliés sont battus et doivent se retirer.
Vandamme, envoyé en poursuite des Alliés après Dresde, s’avance trop loin sans soutien. Il est pris en tenaille par des forces supérieures venues de l’arrière et du flanc. Son corps est presque anéanti, et lui-même est capturé. Cette défaite annule les bénéfices tactiques de Dresde.
Sous une pluie battante, les troupes de Macdonald franchissent la rivière Katzbach pour affronter Blücher, mais le terrain détrempé désorganise leur progression. Blücher contre-attaque vigoureusement sur les flancs, brise l’ordre de bataille français et provoque une déroute. C’est l’une des pires défaites de la campagne.
Chargé de marcher sur Berlin, Ney subit une contre-offensive alliée à Dennewitz. Mal coordonnée, son attaque échoue face à une résistance déterminée et une manœuvre d’enveloppement de Bernadotte. La retraite française dégénère en déroute, mettant fin à l’offensive vers le nord.
La bataille de Leipzig, également appelée 'Bataille des Nations', est la plus grande confrontation militaire des guerres napoléoniennes. Pendant quatre jours, Napoléon résiste à l'assaut coordonné des armées alliées qui convergent sur Leipzig depuis le nord, le sud et l'est. Malgré une défense énergique et plusieurs contre-attaques réussies, la supériorité numérique ennemie devient écrasante. Le 18 octobre, les troupes saxonnes passent dans le camp adverse, désorganisant davantage les lignes françaises. Le 19 octobre, Napoléon ordonne la retraite, mais la destruction prématurée du pont de l'Elster piège 30 000 hommes, dont une partie de la Garde et le maréchal Poniatowski, mort noyé.
Après sa retraite de Leipzig, Napoléon se heurte à une armée bavaro-autrichienne à Hanau qui tente de lui bloquer la route du Rhin. Bien que ses troupes soient fatiguées et inférieures en nombre, il attaque avec violence le 30 octobre. La Garde impériale et l’artillerie brisent le centre ennemi. Wrede se replie en désordre. Le 31, Napoléon poursuit sa progression et franchit la rivière Kinzig, assurant la route vers Mayence.
La bataille de Brienne oppose Napoléon aux troupes prusso-russes de Blücher, dans une tentative de diviser les forces ennemies avant qu'elles ne puissent se regrouper. Napoléon attaque avec vigueur et réussit à surprendre l’ennemi, mais Blücher, bien retranché, parvient à se replier en bon ordre malgré de lourdes pertes. La ville est prise, mais l’objectif stratégique de couper les armées ennemies échoue.
La bataille de La Rothière est l’un des rares engagements en terrain ouvert entre Napoléon et les Alliés en 1814. Surpris par la concentration massive des forces coalisées, Napoléon, en infériorité numérique, tente de tenir ses positions. Les combats sont acharnés dans la neige et la boue. Après avoir résisté toute la journée, Napoléon ordonne la retraite à la nuit tombée. Bien que la bataille soit tactiquement perdue, elle ne se transforme pas en déroute grâce à la discipline française.
À Champaubert, Napoléon surprend un corps russe isolé sous les ordres du général Olssufiev. Grâce à une manœuvre rapide et à l’effet de surprise, il encercle et écrase l’ennemi. La quasi-totalité des troupes russes sont tuées ou capturées. Olssufiev lui-même est fait prisonnier. Cette victoire inaugure une série de coups d’éclat tactiques qui marqueront la campagne des Six Jours.
Au lendemain de Champaubert, Napoléon se tourne vers les forces de Sacken et Yorck, qui avancent séparément en direction de Paris. Il concentre rapidement ses troupes et frappe à Montmirail. L’affrontement est intense mais l’arrivée de la Garde impériale et la supériorité tactique française entraînent la victoire. Les Alliés se replient en désordre, abandonnant hommes et matériel.
Poursuivant les troupes battues à Montmirail, Napoléon rattrape les forces coalisées à Château-Thierry, sur les bords de la Marne. Il lance une attaque vigoureuse pour empêcher leur retraite vers Soissons. Les Alliés sont surpris alors qu’ils traversent le fleuve. La cavalerie française joue un rôle clé, capturant de nombreux canons et prisonniers. La victoire permet de renforcer l’image d’invincibilité de l’armée française dans cette campagne éclair.
Dernière bataille de la campagne des Six Jours, Vauchamps voit Napoléon infliger une sévère défaite aux forces de Blücher, qui avaient tenté d’attaquer l’arrière-garde française. Marmont résiste habilement jusqu’à l’arrivée de renforts menés par Napoléon. Une manœuvre d’encerclement, appuyée par une puissante charge de cavalerie, force les Prussiens à une retraite désastreuse.
À Montereau, Napoléon affronte les troupes austro-wurtembergeoises du prince héritier de Wurtemberg. Après une progression difficile due à la résistance ennemie et à la lenteur de certaines troupes françaises, l’Empereur prend personnellement le commandement sur le terrain. Grâce à une attaque coordonnée sur les ponts de la Seine et de l’Yonne, il inflige une lourde défaite aux coalisés, qui abandonnent la ville.
Macdonald tente de ralentir l’avance de la grande armée de Schwarzenberg à Bar-sur-Aube, mais les forces françaises, en infériorité numérique, sont repoussées après de violents combats. L’ennemi, bien organisé et disposant d’une supériorité écrasante en effectifs et en artillerie, reprend cette position stratégique, ouvrant la voie vers Troyes et la Seine.
La bataille de Craonne oppose les troupes françaises à l’armée de Blücher sur le plateau escarpé dominant l’Aisne. Napoléon, voulant interdire le passage des Alliés vers Laon, ordonne une attaque frontale difficile. Ney lance ses divisions contre les positions retranchées russes. Après de violents combats, les Français parviennent à prendre le plateau, forçant l’ennemi à reculer.
Napoléon tente de reprendre l’initiative face à l’armée de Blücher, solidement retranchée sur les hauteurs de Laon. Malgré une infériorité numérique majeure, il lance plusieurs attaques frontales appuyées par Ney et ses maréchaux. Les assauts échouent en raison du terrain défavorable, du manque de coordination et de la fatigue extrême de l’armée française. Laon reste aux mains des coalisés, marquant un échec stratégique majeur.
Napoléon, réagissant avec une rapidité fulgurante après sa retraite de Laon, surprend le corps allié du général Saint-Priest qui occupe Reims. En quelques heures, les forces françaises reprennent la ville après une attaque bien coordonnée. Saint-Priest est mortellement blessé, et son armée subit des pertes sévères. C’est l’une des dernières victoires éclatantes de Napoléon avant la chute de Paris.
Napoléon tente de surprendre l’armée de Schwarzenberg à Arcis-sur-Aube. Il engage le combat dans l’idée qu’il fait face à une simple arrière-garde, mais découvre trop tard qu’il affronte l’armée principale alliée. Le 20 mars, les Français repoussent les avant-postes ennemis, mais le lendemain, ils se retrouvent en forte infériorité numérique. Napoléon ordonne alors une retraite ordonnée, couverte par la cavalerie de Sébastiani.
Napoléon, espérant détourner les forces alliées de Paris, lance un raid vers l’est et affronte la cavalerie russe à Saint-Dizier. Le combat est vif mais limité, opposant principalement des unités montées. Napoléon tente de faire croire à une grande offensive vers l’est, mais les Alliés ne tombent pas dans le piège et marchent directement sur Paris. Le combat s’achève sans vainqueur décisif.
La bataille de Paris est l’ultime affrontement de la campagne de France. Tandis que Napoléon tente de harceler l’arrière des coalisés à Saint-Dizier, ceux-ci marchent directement sur la capitale. Marmont et Mortier, avec des forces largement inférieures, défendent la ville avec acharnement, notamment à Belleville, Montmartre et Romainville. Le 31 mars, Marmont capitule pour éviter la destruction de Paris.
La bataille de Ligny est le dernier triomphe militaire personnel de Napoléon. Il y écrase partiellement l’armée prussienne commandée par Blücher, qui tente de résister aux Français dans les villages de Ligny et Saint-Amand. La Garde impériale mène l’assaut décisif. Cependant, l’échec de Ney à vaincre Wellington à Quatre-Bras le même jour empêche Napoléon de détruire complètement les Prussiens.
Le même jour que Ligny, Ney tente de prendre le carrefour stratégique de Quatre-Bras afin d’empêcher la jonction entre les armées de Wellington et de Blücher. Malgré une attaque initiale vigoureuse et la prise temporaire du carrefour, Ney ne parvient pas à exploiter l’avantage et est repoussé par les renforts alliés. La bataille se termine sans vainqueur clair, mais les Alliés conservent la position.
La bataille de Waterloo, livrée le 18 juin 1815, marque la fin brutale des Cent-Jours et du destin impérial de Napoléon Bonaparte. Face aux forces anglo-alliées du duc de Wellington et à l’arrivée décisive de l’armée prussienne de Blücher, Napoléon engage sa dernière grande bataille avec l’espoir de détruire ses ennemis séparément. Le matin, le terrain détrempé ralentit les mouvements français, retardant l’assaut. L’affrontement débute par une attaque massive sur la ferme fortifiée d’Hougoumont, suivie de l’engagement du corps de D’Erlon contre le centre allié. L’intervention de la cavalerie britannique, menée par les Scots Greys et les Dragons lourds, repousse la tentative française. À partir de 15h, Ney, croyant à une retraite ennemie, lance plusieurs charges de cavalerie sans appui d’infanterie ni d’artillerie. Ces assauts successifs échouent contre les carrés alliés bien formés. L’arrivée progressive des troupes prussiennes sur le flanc droit français renverse l’équilibre. En fin de journée, Napoléon engage la Garde impériale dans un ultime effort pour percer le centre ennemi. La Garde est repoussée par les troupes britanniques et belgo-néerlandaises, provoquant la panique dans les rangs français. La débandade s’amplifie, et la défaite devient irréversible. Waterloo est plus qu’une défaite militaire : c’est un effondrement stratégique et psychologique.
20 septembre 1792
La bataille de Valmy est une victoire majeure pour la jeune République française. Elle arrête l’avance prussienne vers Paris et galvanise la Révolution.
6 novembre 1792
La bataille de Jemappes est une victoire importante des armées révolutionnaires françaises qui permet la conquête de la Belgique et marque une avancée majeure dans la guerre contre les monarchies coalisées.
2 octobre 1793
La bataille d'Andernach est une victoire française importante qui repousse les forces prussiennes sur la rive est du Rhin, consolidant les gains territoriaux de la République.
18 mars 1793
La bataille de Neerwinden est une défaite française significative qui marque le recul des forces révolutionnaires en Belgique.
13 octobre 1793
La première bataille de Wissembourg est un affrontement indécis entre les forces françaises révolutionnaires et les armées coalisées, qui ne réussit pas à débloquer la situation sur le front rhénan.
26 – 29 décembre 1793
La bataille de Wissembourg est une victoire majeure des armées révolutionnaires françaises qui repoussent les forces coalisées hors d’Alsace et consolident leur contrôle sur la région.
6 – 8 septembre 1793
La bataille de Hondschoote est une victoire française qui met fin au siège de Dunkerque et repousse les forces coalisées hors des Flandres.
25 mai – 27 juillet 1793
Le siège de Valenciennes se solde par une défaite française, la ville tombant aux mains des forces coalisées après un siège prolongé.
15 – 16 octobre 1793
La bataille de Wattignies est une victoire stratégique pour les forces révolutionnaires françaises qui permet de lever le siège de Maubeuge tenu par les troupes autrichiennes. Elle redonne confiance aux armées françaises et sécurise une position clé dans le Nord.
28 novembre – 3 décembre 1793
La bataille de Kaiserslautern est une victoire française clé qui stoppe l’avancée prussienne dans la région et sécurise les positions françaises le long du Rhin.
18 septembre – 19 décembre 1793
Le siège de Toulon est une victoire stratégique pour la République française, qui reprend la ville tenue par des royalistes soutenus par une coalition anglo-espagnole. C’est lors de ce siège que Napoléon Bonaparte se fait remarquer pour ses talents d’artilleur.
26 juin 1794
La bataille de Fleurus est une victoire décisive française qui assure le contrôle de la Belgique et ouvre la voie à la conquête des Pays-Bas autrichiens.
1er juin – 27 juillet 1794
Le siège de Valenciennes est une victoire française importante qui permet de reprendre la ville aux forces coalisées et de consolider la position de la République dans le nord.
22 juin 1795
La bataille de Bâle est une victoire française importante qui assure la domination de la République sur une partie du Rhin supérieur et ouvre la voie à l’occupation de la Suisse.
fin 1795
En 1795, plusieurs escarmouches et engagements ont lieu dans la région de Höchstädt entre les armées françaises et autrichiennes. Ces affrontements n'aboutissent à aucune victoire décisive et se soldent par des retraits mutuels sans changement territorial significatif.
2 octobre 1796
La bataille de Biberach est une victoire française qui renforce la position de Moreau dans le sud de l'Allemagne en repoussant les forces autrichiennes dirigées par Latour.
12 avril 1796
Première grande victoire de Napoléon en Italie, la bataille de Montenotte sépare les forces austro-sardes en deux, compromettant leur coordination et ouvrant la voie à la domination française dans la région.
13 – 14 avril 1796
La bataille de Millesimo consolide la victoire de Montenotte en harcelant les troupes en retraite, perturbant davantage la cohésion des forces austro-sardes.
14 – 15 avril 1796
Victoire qui complète la fragmentation des forces coalisées, donnant aux Français le contrôle d’une position stratégique importante sur la route vers le sud.
21 avril 1796
Victoire française qui force le royaume de Sardaigne à demander un armistice, facilitant la conquête du Piémont.
10 mai 1796
Victoire majeure qui ouvre la voie à la prise de Milan, consolidant la campagne italienne de Napoléon.
5 août 1796
Victoire française qui neutralise une tentative autrichienne de lever le siège de Mantoue.
8 septembre 1796
Victoire qui repousse les Autrichiens vers l’est, consolidant le contrôle français en Vénétie.
30 octobre 1796
Engagement tactique qui ne modifie pas substantiellement la situation stratégique dans la région.
15 – 17 novembre 1796
Victoire française grâce à une offensive audacieuse qui prend le contrôle du pont d’Arcole, stoppant l’avance autrichienne.
14 – 15 janvier 1797
Victoire décisive mettant fin à l’offensive autrichienne et assurant la domination française en Italie du Nord.
18 avril 1797
Victoire stratégique de Hoche qui force les Autrichiens à reculer, consolidant la position française le long du Rhin.
21 juillet 1798
Victoire décisive de Napoléon qui brise la puissance militaire des Mamelouks en Égypte, ouvrant la voie à la conquête française du pays.
1er août 1798
Défaite navale majeure pour la France où la flotte de Brueys est anéantie par la marine britannique commandée par Nelson, isolant l’armée française en Égypte.
25 mars 1799
Défaite française lourde qui force Jourdan à battre en retraite, affaiblissant la position française dans le sud-ouest de l’Allemagne.
25 juillet 1799
Victoire française qui défend avec succès la position d’Alexandrie contre une offensive ottomane, consolidant la présence française en Égypte malgré l’isolement maritime.
15 août 1799
Le 15 août 1799, la bataille de Novi oppose l’armée française du général Joubert à une coalition austro-russe dirigée par le maréchal Souvorov et le général Kray. Dès les premières heures, Joubert est mortellement touché, privant les Français d’un commandement centralisé, ce qui déstabilise gravement leurs lignes. Les troupes françaises, déjà éprouvées par les précédents combats et en infériorité numérique, affrontent néanmoins avec acharnement les attaques répétées des coalisés. La journée est marquée par des assauts frontaux et des contre-attaques locales, où l’armée française fait preuve d’une résistance remarquable mais insuffisante. La bataille, l’une des plus sanglantes de la campagne d’Italie, se conclut par une défaite française majeure et par un retrait précipité vers les Apennins.
25-26 septembre 1799
Victoire française majeure sous Masséna qui force la coalition à se retirer de Suisse, assurant un contrôle stratégique de la région.
20 mars 1800
Victoire française décisive sous Kléber qui repousse une grande armée ottomane, sécurisant la domination française sur le delta du Nil.
9 mai 1800
Victoire française importante qui permet de repousser les forces autrichiennes et de sécuriser la progression française en Allemagne du Sud.
14 juin 1800
La bataille de Marengo est une victoire décisive de Napoléon Bonaparte qui assure le contrôle de l’Italie du Nord. Après un début difficile, l’armée française, grâce à une contre-attaque menée par Desaix, renverse la situation et inflige une lourde défaite aux Autrichiens.
14 octobre 1800
La bataille d'Elchingen, souvent appelée bataille de Höchstädt, est une victoire décisive des forces françaises sous le commandement du général Ney, qui permet la rupture des lignes autrichiennes et la reprise de l'offensive en Allemagne du Sud.
3 décembre 1800
Victoire décisive de Moreau lors de la bataille de Hohenlinden, qui inflige une lourde défaite aux Autrichiens et permet la poursuite de l’offensive française en Allemagne.
25 décembre 1800
La bataille de Pozzolo est une victoire française importante qui permet de repousser les forces autrichiennes au-delà du Mincio et consolider la domination française en Lombardie.
mai – août 1801
L'expédition française en Hollande vise à repousser les forces coalisées britanniques et russes qui occupaient la République batave. Moreau réussit à restaurer le contrôle français sur la région.
21 mars – 22 juin 1801
Le siège du Caire se termine par la capitulation des forces françaises face aux troupes britanniques, mettant fin à la campagne française en Égypte.
17 août – 2 septembre 1801
Le siège d’Alexandrie se termine par la capitulation des forces françaises face aux Britanniques, mettant fin à la présence française en Égypte.
21 mars 1801
Défaite navale française près d’Alexandrie, réduisant significativement la capacité maritime française en Méditerranée et coupant définitivement les liens entre la France et ses troupes en Égypte.
février – décembre 1802
En 1802, la France lance une grande expédition militaire dirigée par le général Leclerc pour rétablir le contrôle sur sa colonie de Saint-Domingue, gravement secouée par la rébellion des esclaves. Malgré des victoires tactiques initiales, la campagne se heurte à une résistance acharnée des insurgés et à des pertes massives dues aux combats et maladies tropicales.
4 février – 24 mars 1802
Le fort Crête-à-Pierrot, tenu par les insurgés haïtiens, est assiégé par les troupes françaises dans une bataille prolongée. Malgré une résistance féroce des insurgés, les Français prennent finalement le fort après plusieurs semaines de combats.
mars – avril 1802
Le siège de la ville portuaire de Saint-Marc est mené par les forces françaises cherchant à reprendre une position stratégique tenue par les insurgés. Après plusieurs semaines de combat, les Français réussissent à s’emparer de la ville.
18 novembre 1803
La bataille de Vertières est le dernier grand affrontement de la guerre d'indépendance haïtienne. Les forces françaises, affaiblies par les combats prolongés et les maladies, sont défaites par l'armée insurgée haïtienne menée par Dessalines. Cette défaite entraîne la reddition finale des troupes françaises et marque la fin de la présence coloniale française à Saint-Domingue.
juin 1803
Après la rupture de la paix d'Amiens, les Britanniques reprennent l'île stratégique de Saint-Lucie dans les Antilles, reprenant le contrôle des territoires colonisés pendant la courte paix.
mai – novembre 1803
Le siège du Cap-Français est un long siège qui affaiblit progressivement les forces françaises dans leur principal bastion en Saint-Domingue. La résistance haïtienne, combinée aux conditions difficiles, mène à la reddition finale après la bataille de Vertières.
8 octobre 1805
La bataille de Wertingen est le premier affrontement de la campagne d'Ulm. La cavalerie française, dirigée par Murat, balaie l’avant-garde autrichienne dans une attaque rapide et violente. Lannes soutient l’offensive avec de l’infanterie.
9 octobre 1805
Lannes reçoit l'ordre de s'emparer des ponts sur le Danube à Günzburg pour couper la retraite des Autrichiens vers l'est. Il lance plusieurs assauts contre les défenses autrichiennes qui protègent les passages stratégiques.
11 octobre 1805
La division Dupont, isolée, se heurte à une force autrichienne écrasante près d’Ulm. Malgré son infériorité numérique, elle tient sa position pendant plusieurs heures, infligeant de lourdes pertes et empêchant toute percée stratégique.
14 octobre 1805
La bataille d’Elchingen est un affrontement crucial dans le resserrement de l’étau autour d’Ulm. Ney lance une attaque vigoureuse contre les forces autrichiennes retranchées sur les hauteurs d’Elchingen, les forçant à battre en retraite dans le désordre.
20 octobre 1805
La capitulation d’Ulm met un terme à l’encerclement stratégique orchestré par Napoléon. Le général autrichien Karl Mack se rend avec près de 27 000 hommes sans véritable bataille, pris au piège par la rapidité de manœuvre de la Grande Armée.
21 octobre 1805
Trafalgar est la plus célèbre bataille navale des guerres napoléoniennes. La flotte franco-espagnole tente de briser le blocus britannique, mais est interceptée et détruite par Nelson, dont la tactique audacieuse conduit à une victoire écrasante malgré sa mort au combat.
29 – 31 octobre 1805
La bataille de Caldiero oppose les troupes de Masséna à celles de l’archiduc Charles dans des conditions météorologiques difficiles. Malgré plusieurs tentatives, les Français ne parviennent pas à percer les lignes autrichiennes.
11 novembre 1805
La division Gazan, isolée dans une gorge du Danube, est encerclée et attaquée de tous côtés par une force austro-russe bien supérieure. Mortier envoie des renforts pour éviter l’anéantissement. Les combats sont sanglants et intenses, mais les Français parviennent à se dégager.
16 novembre 1805
Dans cette action d’arrière-garde, le général russe Bagration retarde habilement l’avance française pour permettre au gros de l’armée austro-russe de se replier vers Brünn et rejoindre Koutouzov. Murat tombe dans le piège diplomatique des Russes, acceptant un faux armistice pour gagner du temps.
2 décembre 1805
La bataille d’Austerlitz, dite « des Trois Empereurs », marque l’apogée de la stratégie napoléonienne. Face à une armée alliée supérieure en nombre, Napoléon utilise la ruse, la préparation minutieuse du terrain et la mobilité de ses troupes pour transformer une position apparemment défavorable en une victoire écrasante. Il choisit délibérément de placer son armée sur le plateau de Pratzen, qu’il fait ensuite évacuer afin d’attirer l’ennemi à y concentrer ses forces. Convaincus que le flanc droit français est affaibli, les Austro-Russes y lancent l’essentiel de leurs troupes. Cette manœuvre affaiblit dangereusement leur centre, qu’ils estiment hors d’atteinte. Napoléon attend que l’ennemi s’engage pleinement dans cette erreur avant de donner l’ordre au corps de Soult, dissimulé dans la brume, de monter à l’assaut du plateau. La percée du centre coupe littéralement l’armée alliée en deux, semant la panique et rendant toute coordination impossible. Sur les ailes, Davout et Lannes résistent ou progressent selon le plan, tandis que la cavalerie de Murat et la Garde impériale exploitent l’effondrement du dispositif ennemi pour capturer des milliers de prisonniers. La déroute est totale : de nombreux soldats austro-russes se noient en tentant de fuir à travers les étangs gelés de Satschan, sous le feu de l’artillerie française. Austerlitz est non seulement un chef-d’œuvre tactique, mais aussi un tournant politique pour l’Europe, la victoire plaçant Napoléon au sommet de sa gloire et bouleversant l’équilibre continental.
10 octobre 1806
La bataille de Saalfeld voit la rencontre entre l’avant-garde française de Lannes et un corps prussien commandé par le jeune prince Louis-Ferdinand. Malgré sa bravoure, ce dernier meurt au combat, et ses troupes sont défaites par des manœuvres habiles des troupes françaises.
14 octobre 1806
La bataille de Iéna voit Napoléon écraser l'aile gauche de l'armée prussienne. Malgré un brouillard matinal et des informations incomplètes, l’Empereur manœuvre habilement ses corps d’armée pour submerger les positions ennemies. L’arrivée en renfort du corps de Davout à Auerstaedt le même jour parachève une déroute générale.
14 octobre 1806
Le même jour que Napoléon à Iéna, Davout se retrouve face à l’essentiel de l’armée prussienne. Malgré une infériorité numérique de 1 contre 2, il résiste toute la journée grâce à la discipline exceptionnelle de ses troupes. Le général Brunswick est mortellement blessé, la chaîne de commandement prussienne s’effondre, et Davout transforme une position défensive en victoire éclatante.
17 octobre 1806
Trois jours après Iéna, Bernadotte intercepte à Halle une importante division prussienne en retraite. Il lance une attaque brutale contre leurs positions retranchées, prenant la ville de vive force, coupant les ponts et semant le chaos dans les rangs ennemis.
28 octobre 1806
La colonne prussienne du prince Hohenlohe, en retraite après Iéna, est interceptée près de Prenzlau par la cavalerie de Murat. Une brève escarmouche dégénère en encerclement, et Murat force Hohenlohe à capituler en exagérant la force française. La ruse, la vitesse et la pression tactique triomphent.
6 novembre 1806
Cherchant à échapper à l’encerclement, Blücher tente de se réfugier à Lübeck, ville libre et neutre. Les Français forcent l’entrée de la ville, malgré les protestations des autorités, et livrent bataille dans les rues. Les combats sont intenses et se terminent par la capitulation prussienne.
8 novembre 1806
Après un court siège, la puissante forteresse de Magdebourg, l’une des plus importantes de Prusse, capitule sans offrir de réelle résistance. Ney, encerclant la ville et bombardant ses abords, convainc le commandant prussien de se rendre.
26 décembre 1806
Dans une offensive hivernale éprouvante, les forces françaises engagent l’arrière-garde russe à Gołymin. Les combats sont confus, rendus difficiles par la neige, la boue et la tombée de la nuit. Les Russes résistent fermement, puis parviennent à se replier en bon ordre.
26 décembre 1806
Dans des conditions météorologiques extrêmes, Lannes affronte une armée russe supérieure en nombre à Pułtusk. Bien qu’attaqué violemment, Bennigsen refuse de reculer immédiatement et soutient le combat toute la journée. À la tombée de la nuit, les Russes se retirent en bon ordre, mais les deux camps revendiquent la victoire.
25 janvier 1807
Dans une phase de redéploiement hivernal, Ney est surpris par une offensive russe près de Mohrungen. Ses troupes, en infériorité numérique, résistent avec acharnement et empêchent les Russes de pénétrer plus profondément dans la zone française. Après de violents combats, les Russes se replient.
6 février 1807
La cavalerie française de Murat engage les avant-gardes russes dans un terrain glacé et difficile. Les combats sont violents mais confus, se terminant sans vainqueur clair. Cette bataille prépare le terrain pour la confrontation décisive à Eylau deux jours plus tard.
8 février 1807
Eylau est l’une des batailles les plus violentes de l’ère napoléonienne. Sous une tempête de neige, les Français attaquent les lignes russes autour de la ville d’Eylau. Le champ de bataille est chaotique, la visibilité nulle. Murat mène une charge de cavalerie de plus de 10 000 hommes pour stopper l’avance ennemie. À la fin de la journée, les deux camps restent sur le terrain, exsangues. Napoléon revendique la victoire, mais le résultat est militairement indécis.
16 février 1807
La division Verdier, isolée à Ostrołęka, est attaquée par une force russe bien supérieure. Verdier défend habilement ses positions, repousse plusieurs assauts et conserve le contrôle de la ville après une journée de combats acharnés.
10 juin 1807
La bataille de Heilsberg oppose les forces françaises aux Russes solidement retranchés sur les hauteurs derrière la rivière Alle. L’attaque française, mal coordonnée, se heurte à une défense acharnée. Les pertes sont lourdes des deux côtés, et les Français ne parviennent pas à percer.
14 juin 1807
La bataille de Friedland oppose les forces françaises de Napoléon à l’armée russe de Bennigsen, qui a imprudemment engagé le combat avec la rivière Alle dans son dos. Après une défense tenace menée par Lannes le matin, Napoléon arrive avec le gros de ses forces, déclenche une attaque massive sur le flanc gauche russe et écrase l’armée ennemie. La victoire est totale, scellant la fin de la campagne.
6 et 14 juin 1808
Les deux affrontements d’El Bruc voient des colonnes françaises attaquées dans les montagnes catalanes par des milices locales. Mal préparées au terrain, les forces de Schwartz puis de Chabran sont repoussées par une défense tenace, renforcée par l’effet de surprise et le soutien populaire.
14 juillet 1808
La bataille de Medina de Rioseco voit les forces françaises de Bessières attaquer une armée espagnole divisée. Profitant du manque de coordination entre les généraux Blake et Cuesta, Bessières lance une attaque décisive sur le centre et détruit l’union des forces ennemies. C’est l’un des rares succès français du début de la guerre d’Espagne.
19 juillet 1808
La bataille de Bailén oppose les troupes françaises du général Dupont, isolées dans la vallée du Guadalquivir, aux armées espagnoles de Castaños et Reding. Après plusieurs jours d’escarmouches, les Français tentent de percer, mais sont pris en tenaille. Accablés par la chaleur, le manque de vivres et l’encerclement, Dupont capitule avec toute son armée.
29 juillet 1808
Loison marche vers Lisbonne depuis l’intérieur du Portugal pour soutenir les forces d’occupation. À Évora, il rencontre une résistance formée de milices locales et de volontaires espagnols. Après une courte bataille, les Français balaient les positions ennemies et prennent la ville, qui est ensuite pillée par les troupes.
17 août 1808
Le général Delaborde, en infériorité numérique, tente de ralentir l’avance britannique vers Lisbonne. Il se positionne sur les hauteurs de Roliça. Wellesley tente d’abord un mouvement d’encerclement, puis une attaque frontale. Malgré une résistance tenace, les Français sont repoussés mais se retirent en bon ordre.
21 août 1808
Junot tente une attaque frontale contre les positions fortifiées de Wellesley autour de Vimeiro. Malgré plusieurs assauts déterminés, les Français échouent à percer. La supériorité défensive britannique, l’artillerie bien positionnée, et l’utilisation du terrain empêchent toute avancée française. Junot est contraint de battre en retraite.
31 octobre 1808
Blake, mal positionné sur les hauteurs de Zornoza, est attaqué par Lefebvre avec une partie du IVᵉ corps. Les Français prennent l’avantage dès le début grâce à leur artillerie et leur discipline supérieure. Blake parvient à se retirer mais subit de lourdes pertes.
5 novembre 1808
Alors qu’une division du maréchal Victor progresse isolée à l’avant, Blake parvient à la surprendre avec une attaque en force. Les Français sont momentanément battus et contraints de se replier. Il s’agit d’un rare succès espagnol pendant la campagne de novembre.
10 novembre 1808
La bataille de Gamonal oppose l’avant-garde française de Soult à une force espagnole inférieure commandée par Belveder. Les Espagnols, inexpérimentés et mal positionnés en plaine, sont balayés par l’infanterie française soutenue par une puissante charge de cavalerie. La route de Burgos est ouverte.
10–11 novembre 1808
Après la surprise de Valmaseda, Victor poursuit Blake et le rattrape à Espinosa. Le 10 novembre, les Espagnols résistent aux premières attaques, mais le lendemain, Victor concentre ses forces, brise le centre espagnol et disperse l’armée. C’est une victoire complète qui élimine temporairement la menace dans le nord.
23 novembre 1808
La bataille de Tudela oppose une armée espagnole mal coordonnée à une force française supérieure en organisation. Lannes attaque le centre et la droite espagnole, rompant leur ligne, tandis que Moncey poursuit l’effort sur l’aile gauche. L’armée espagnole est disloquée et en fuite avant la tombée de la nuit.
30 novembre 1808
Pour ouvrir la route vers Madrid, Napoléon fait attaquer les redoutes espagnoles défendant le col de Somosierra. Après plusieurs assauts d’infanterie infructueux, il ordonne une charge audacieuse des chasseurs polonais de la Garde. Ces derniers percent les lignes ennemies, capturent les canons et forcent les Espagnols à la retraite. La route vers la capitale est dégagée.
16 décembre 1808
Saint-Cyr, marchant depuis Gérone pour secourir Barcelone assiégée, affronte une armée espagnole inférieure en nombre mais solidement positionnée à Cardedeu. Il concentre ses forces pour une percée frontale rapide, qui rompt les lignes espagnoles. L’armée de Vives se débande et permet à Saint-Cyr de débloquer la ville peu après.
21 décembre 1808
Après sa victoire à Cardedeu, Saint-Cyr poursuit l’offensive et attaque les forces combinées de Vives et Reding retranchées à Molins de Rei, en périphérie de Barcelone. L'assaut frontal coordonné, soutenu par l’artillerie, rompt les lignes espagnoles. L’armée ennemie se débande, et Barcelone est définitivement libérée du siège.
29 décembre 1808
Dans le contexte de la retraite britannique vers La Corogne, les chasseurs de la Garde de Lefebvre-Desnouettes franchissent le fleuve Esla gelé pour tenter une attaque surprise sur l’arrière-garde anglaise. Mais les hussards britanniques réagissent rapidement, contre-chargent, et infligent une défaite aux Français. Lefebvre est capturé.
3 janvier 1809
En poursuivant les forces britanniques en retraite, la cavalerie française atteint le pont de Cacabelos défendu par l’arrière-garde anglaise. Une attaque est lancée sans coordination avec l’infanterie française. Les Britanniques, bien postés, infligent des pertes et tuent le général Colbert d’un tir de tireur d’élite. Les Français reculent en attendant les renforts.
13 janvier 1809
Victor attaque les forces espagnoles retranchées près du monastère d’Uclès. L’assaut bien coordonné brise la ligne ennemie, et la cavalerie française exploite la percée pour encercler les fuyards. La déroute est complète, et Venegas échappe de peu à la capture.
16 janvier 1809
Acculée à la mer après une longue retraite, l’armée britannique défend la ville portuaire de La Corogne en attendant l’évacuation par mer. Soult attaque le 16 janvier, espérant empêcher leur fuite. Les Britanniques tiennent bon et résistent aux assauts français, réussissant à embarquer la majorité de leurs troupes durant la nuit. Moore est tué lors des combats.
1er février 1809
Suchet affronte l’armée valencienne près de Castellón dans une bataille décisive pour sécuriser le flanc est de l’Espagne. Bien que légèrement inférieurs en nombre, les Français engagent une attaque méthodique et enfoncent le centre espagnol. La cavalerie française poursuit les fuyards et achève la victoire.
25 février 1809
Suchet, voulant sécuriser la province de Tarragone, intercepte l’armée de Reding près de Valls. Après une reconnaissance prudente, il déclenche une attaque combinée au centre et sur les flancs. La cavalerie française, conduite avec habileté, exécute une manœuvre tournante qui piège les Espagnols. Reding est blessé mortellement dans la déroute.
28 mars 1809
Malgré l’infériorité numérique, Victor engage une manœuvre décisive contre l’armée de Cuesta disposée sur une large ligne étendue. Après avoir contenu les attaques espagnoles sur ses ailes, il lance une contre-offensive centrale appuyée par l’artillerie et la cavalerie. L’armée espagnole est totalement mise en déroute.
12 mai 1809
Wellesley mène une attaque surprise audacieuse sur Porto, traversant le Douro avec une force légère avant que Soult ne puisse réagir. Pris de vitesse, le maréchal français tente de rassembler ses troupes, mais le pont est coupé et les forces anglaises avancent rapidement dans la ville. La retraite devient inévitable.
14 juin 1809
La colonne française du général Schwartz, envoyée depuis Barcelone pour sécuriser la route vers Lérida, est stoppée dans le col d’El Bruc par des milices catalanes déterminées. Ces dernières, appuyées par des troupes régulières, utilisent les hauteurs et des embuscades coordonnées pour bloquer l’avance française. Après plusieurs tentatives de percée, Schwartz bat en retraite vers Barcelone.
5–6 juillet 1809
La bataille de Wagram fut l’un des plus grands affrontements des guerres napoléoniennes, opposant les forces de Napoléon Ier à l’armée autrichienne commandée par l’archiduc Charles. Après avoir subi un revers à Aspern-Essling, Napoléon passe à nouveau le Danube début juillet 1809 à l’aide d’un vaste pont de bateaux construit en secret. Le 5 juillet, l’armée française est attaquée alors qu’elle est encore en déploiement, mais résiste aux assauts. Le lendemain, Napoléon organise une contre-offensive décisive, appuyée par une concentration massive d’artillerie au centre (la « grande batterie ») et une attaque puissante sur l’aile droite menée par le maréchal Davout. L’archiduc Charles, incapable de percer les lignes françaises ni de contenir leurs attaques coordonnées, ordonne la retraite dans la soirée du 6 juillet. Cette victoire permet à Napoléon d’imposer des conditions sévères à l’Autriche.
27–28 juillet 1809
Les forces françaises de Joseph Bonaparte et du maréchal Victor attaquent les positions retranchées anglo-espagnoles autour de Talavera. La bataille est sanglante et acharnée, avec des assauts répétés contre les hauteurs tenues par les troupes de Wellington. Après deux jours de combat, les Français échouent à percer les lignes britanniques. Cependant, les alliés ne peuvent exploiter leur victoire en raison de la fatigue, des pertes et de l’arrivée d’une nouvelle armée française sur leurs arrières.
11 août 1809
Les forces espagnoles de Venegas, tentant de marcher sur Madrid après la bataille de Talavera, sont interceptées à Almonacid par le général Sébastiani. Malgré leur supériorité numérique et une position défensive sur les hauteurs, les Espagnols sont repoussés après une série d’assauts coordonnés par l’infanterie et l’artillerie française. Leur ligne cède dans l’après-midi, et une retraite désorganisée s’ensuit.
21 septembre 1809
Les Britanniques lancent un raid amphibie sur le port de Saint-Paul pour capturer la goélette corsaire française Caroline, très active dans l’océan Indien. Le gouverneur Des Bruslys, miné par la pression, se suicide la veille. Le colonel Saint-Michel organise une défense avec des miliciens et quelques pièces d’artillerie côtière, mais les Britanniques parviennent à débarquer, capturer le fortin, désarmer les batteries et incendier le port. La Caroline est saisie.
18 octobre 1809
L’armée espagnole du duc del Parque occupe les hauteurs de Tamames et repousse frontalement l’attaque du général Marchand. Malgré plusieurs assauts, les troupes françaises, en infériorité numérique et mal coordonnées, ne parviennent pas à briser la ligne espagnole. La bataille marque l’un des rares succès tactiques espagnols en 1809.
19 novembre 1809
Malgré leur infériorité numérique, Soult et Sébastiani affrontent l’armée espagnole d’Aréizaga près d’Ocaña. Grâce à une puissante attaque d’artillerie, une manœuvre de cavalerie sur l’aile droite et une infanterie expérimentée, les Français infligent une déroute totale aux Espagnols. L’armée de La Mancha est détruite.
28 novembre 1809
Profitant du retrait précipité des troupes espagnoles du duc del Parque après Tamames, le général Kellermann engage une poursuite rapide. L’arrière-garde espagnole, surprise près du pont d’Alba de Tormes, est attaquée par la cavalerie française avant que l’armée entière ne puisse traverser la rivière. Les formations ennemies sont rompues et l’artillerie capturée.
20–27 août 1810
La bataille de Grand Port est la seule victoire navale française majeure des guerres napoléoniennes après Trafalgar. Les frégates françaises de Duperré et Bouvet, aidées de batteries côtières, attirent les navires britanniques dans un lagon étroit. La flotte ennemie s’embourbe sur les récifs. Les Français détruisent deux navires et en capturent deux autres. C’est un revers retentissant pour la Royal Navy.
27 septembre 1810
Masséna tente de percer la ligne défensive anglo-portugaise retranchée sur les hauteurs de Bussaco. L’assaut frontal mené par Reynier et Ney échoue face à une défense bien organisée et une artillerie alliée bien positionnée. Malgré sa supériorité numérique, l’armée française subit une défaite coûteuse et tactique.
5 mars 1811
La bataille de Barrosa voit les troupes françaises du général Victor tenter d’intercepter une tentative de sortie anglo-espagnole de Cadix. Bien que les Espagnols hésitent, les Britanniques de Graham montent une attaque énergique sur les hauteurs de Barrosa. Après un combat acharné, les Français sont repoussés, mais conservent leurs positions stratégiques. La bataille est considérée comme indécise, voire tactiquement favorable aux Alliés.
3 avril 1811
La bataille de Sabugal se déroule lors de la retraite de Masséna du Portugal. Le général Reynier, à l’arrière-garde, est attaqué de manière inattendue par une brigade britannique ayant franchi la rivière sous la brume. Malgré une résistance initiale, ses troupes sont mises en difficulté et doivent battre en retraite en désordre.
3–5 mai 1811
La bataille oppose Masséna, qui tente de dégager la garnison française assiégée à Almeida, à Wellington, solidement retranché à Fuentes de Oñoro. Après deux jours d’escarmouches, Masséna lance une attaque massive le 5 mai. Malgré un succès initial sur le flanc droit britannique, la résistance alliée tient bon. L’armée française se retire sans briser le blocus.
16 mai 1811
Soult tente de lever le siège de Badajoz en attaquant l’armée alliée à Albuera. L’assaut frontal français, dirigé par Godinot puis Girard, est initialement couronné de succès. Mais une contre-attaque acharnée de l’infanterie britannique et la ténacité des troupes espagnoles brisent l’élan français. Les deux camps subissent de lourdes pertes, sans victoire décisive.
9 août 1811
La bataille de Zújar oppose la cavalerie française commandée par Latour-Maubourg à une force espagnole isolée tentant d’interrompre les communications françaises dans le sud-ouest de l’Espagne. Grâce à une manœuvre habile de contournement, la cavalerie française disperse les forces ennemies et capture un grand nombre de prisonniers.
29 août 1811
Le général Hugo intercepte une force mobile de guérilla commandée par 'El Empecinado' dans la région montagneuse de Cuenca. Grâce à un mouvement de flanc et à l’effet de surprise, les troupes françaises parviennent à encercler partiellement les Espagnols et à infliger de lourdes pertes.
25 octobre 1811
Suchet affronte l'armée espagnole de Blake, venue tenter de dégager la ville assiégée de Sagonte. Grâce à une attaque déterminée sur le centre ennemi, les troupes françaises enfoncent les lignes espagnoles et obtiennent une victoire décisive, ouvrant la route vers Valence.
26–30 décembre 1811
Suchet lance une manœuvre audacieuse pour prendre Valence en encerclant les forces de Blake. Après des combats intenses autour de Mislata et de la rivière Turia, l’armée espagnole est prise au piège. Blake tente une percée mais échoue, et doit capituler avec une grande partie de ses troupes.
7–20 janvier 1812
Wellington lance un assaut rapide contre Ciudad Rodrigo, tenue par une petite garnison française. Après un bombardement intense de plusieurs jours, les troupes anglo-portugaises percent les murs de la ville et lancent un assaut nocturne. La garnison française est submergée malgré une défense courageuse.
16 mars – 6 avril 1812
Après un siège éprouvant et plusieurs jours de bombardement intensif, les forces anglo-portugaises lancent un assaut nocturne contre les fortifications de Badajoz. Malgré une défense acharnée des Français, les Alliés parviennent à s’emparer de la ville après de violents combats de rue.
22 juillet 1812
La bataille de Salamanque voit l’armée du Portugal, dirigée par Marmont, surprise et battue par une attaque habile de Wellington. Une fausse manœuvre de Marmont expose son flanc gauche, que les Alliés exploitent avec une attaque décisive qui brise les lignes françaises.
16–18 août 1812
Napoléon attaque la ville fortifiée de Smolensk pour y fixer l’armée russe et forcer une bataille décisive. Malgré des combats intenses et des bombardements dévastateurs, les Russes finissent par abandonner la ville dans la nuit, permettant aux Français de s’en emparer.
7 septembre 1812
La bataille de la Moskova, dite bataille de Borodino, est l’affrontement le plus sanglant des guerres napoléoniennes. Napoléon tente de briser l’armée russe avant d’atteindre Moscou. Après une journée d’assauts frontaux meurtriers sur les redoutes russes, les Français parviennent à percer le centre ennemi, sans pour autant détruire l’armée russe, qui se replie dans l’ordre.
18 octobre 1812
Alors que Murat observait les Russes campés à Taroutino dans le cadre du repli général français, ceux-ci lancent une attaque surprise à l’aube. L’avant-garde française est surprise, subit de lourdes pertes, et bat en retraite en désordre. Napoléon perd l’initiative stratégique.
24 octobre 1812
Dans une tentative de retraite par le sud, Napoléon fait avancer les troupes d’Eugène vers Kalouga. À Maloyaroslavets, elles affrontent les forces russes dans un combat urbain acharné. La ville change de mains plusieurs fois. Bien que les Français prennent l’avantage, Napoléon choisit de se replier par la route déjà ravagée de Smolensk.
28 octobre 1812
Surpris par une attaque russe alors qu’il menait l’arrière-garde de la retraite de Moscou, Murat est forcé au combat à Vinkovo. Ses forces sont débordées par la supériorité numérique de l’ennemi et doivent abandonner le terrain, rompant ainsi la couverture du repli.
15–18 novembre 1812
Durant la retraite de Russie, plusieurs corps de la Grande Armée sont attaqués séparément par les Russes près de Krasnoï. Napoléon parvient à dégager Eugène et Davout, mais le corps de Ney est isolé et durement frappé. Il parvient néanmoins à rejoindre l’armée après une marche légendaire.
26–29 novembre 1812
Dans une tentative désespérée de traverser la Bérézina pour échapper à l’encerclement, Napoléon fait ériger deux ponts sous le feu russe. Grâce à une diversion réussie, les troupes françaises parviennent à franchir la rivière au prix de lourdes pertes. Le terme 'c’est la Bérézina' naît de cette retraite sanglante.
2 mai 1813
Lützen est la première grande bataille de la campagne d’Allemagne. Surpris par une attaque des troupes russo-prussiennes sur son flanc, Napoléon réagit avec célérité, rassemble ses forces, et lance une contre-attaque massive. Les Alliés se retirent en ordre mais concèdent le champ de bataille.
20–21 mai 1813
Napoléon lance une attaque massive sur les forces russo-prussiennes retranchées à Bautzen. Malgré des combats violents et une supériorité numérique, l’armée alliée parvient à battre en retraite. La coordination imparfaite entre Ney et Napoléon empêche l’encerclement attendu.
21 juin 1813
Wellington lance une attaque coordonnée sur quatre axes contre les positions françaises à Vitoria. Débordés sur leurs flancs et au centre, les Français battent en retraite en désordre. La déroute est aggravée par la perte du trésor et des bagages de Joseph Bonaparte.
26–27 août 1813
Les Alliés lancent une attaque sur Dresde en pensant affronter une force française inférieure. Mais Napoléon arrive à temps avec des renforts et organise une contre-offensive efficace, en exploitant le terrain détrempé pour piéger l’ennemi. Les Alliés sont battus et doivent se retirer.
29–30 août 1813
Vandamme, envoyé en poursuite des Alliés après Dresde, s’avance trop loin sans soutien. Il est pris en tenaille par des forces supérieures venues de l’arrière et du flanc. Son corps est presque anéanti, et lui-même est capturé. Cette défaite annule les bénéfices tactiques de Dresde.
26 août 1813
Sous une pluie battante, les troupes de Macdonald franchissent la rivière Katzbach pour affronter Blücher, mais le terrain détrempé désorganise leur progression. Blücher contre-attaque vigoureusement sur les flancs, brise l’ordre de bataille français et provoque une déroute. C’est l’une des pires défaites de la campagne.
6 septembre 1813
Chargé de marcher sur Berlin, Ney subit une contre-offensive alliée à Dennewitz. Mal coordonnée, son attaque échoue face à une résistance déterminée et une manœuvre d’enveloppement de Bernadotte. La retraite française dégénère en déroute, mettant fin à l’offensive vers le nord.
16–19 octobre 1813
La bataille de Leipzig, également appelée 'Bataille des Nations', est la plus grande confrontation militaire des guerres napoléoniennes. Pendant quatre jours, Napoléon résiste à l'assaut coordonné des armées alliées qui convergent sur Leipzig depuis le nord, le sud et l'est. Malgré une défense énergique et plusieurs contre-attaques réussies, la supériorité numérique ennemie devient écrasante. Le 18 octobre, les troupes saxonnes passent dans le camp adverse, désorganisant davantage les lignes françaises. Le 19 octobre, Napoléon ordonne la retraite, mais la destruction prématurée du pont de l'Elster piège 30 000 hommes, dont une partie de la Garde et le maréchal Poniatowski, mort noyé.
30–31 octobre 1813
Après sa retraite de Leipzig, Napoléon se heurte à une armée bavaro-autrichienne à Hanau qui tente de lui bloquer la route du Rhin. Bien que ses troupes soient fatiguées et inférieures en nombre, il attaque avec violence le 30 octobre. La Garde impériale et l’artillerie brisent le centre ennemi. Wrede se replie en désordre. Le 31, Napoléon poursuit sa progression et franchit la rivière Kinzig, assurant la route vers Mayence.
29 janvier 1814
La bataille de Brienne oppose Napoléon aux troupes prusso-russes de Blücher, dans une tentative de diviser les forces ennemies avant qu'elles ne puissent se regrouper. Napoléon attaque avec vigueur et réussit à surprendre l’ennemi, mais Blücher, bien retranché, parvient à se replier en bon ordre malgré de lourdes pertes. La ville est prise, mais l’objectif stratégique de couper les armées ennemies échoue.
1er février 1814
La bataille de La Rothière est l’un des rares engagements en terrain ouvert entre Napoléon et les Alliés en 1814. Surpris par la concentration massive des forces coalisées, Napoléon, en infériorité numérique, tente de tenir ses positions. Les combats sont acharnés dans la neige et la boue. Après avoir résisté toute la journée, Napoléon ordonne la retraite à la nuit tombée. Bien que la bataille soit tactiquement perdue, elle ne se transforme pas en déroute grâce à la discipline française.
10 février 1814
À Champaubert, Napoléon surprend un corps russe isolé sous les ordres du général Olssufiev. Grâce à une manœuvre rapide et à l’effet de surprise, il encercle et écrase l’ennemi. La quasi-totalité des troupes russes sont tuées ou capturées. Olssufiev lui-même est fait prisonnier. Cette victoire inaugure une série de coups d’éclat tactiques qui marqueront la campagne des Six Jours.
11 février 1814
Au lendemain de Champaubert, Napoléon se tourne vers les forces de Sacken et Yorck, qui avancent séparément en direction de Paris. Il concentre rapidement ses troupes et frappe à Montmirail. L’affrontement est intense mais l’arrivée de la Garde impériale et la supériorité tactique française entraînent la victoire. Les Alliés se replient en désordre, abandonnant hommes et matériel.
12 février 1814
Poursuivant les troupes battues à Montmirail, Napoléon rattrape les forces coalisées à Château-Thierry, sur les bords de la Marne. Il lance une attaque vigoureuse pour empêcher leur retraite vers Soissons. Les Alliés sont surpris alors qu’ils traversent le fleuve. La cavalerie française joue un rôle clé, capturant de nombreux canons et prisonniers. La victoire permet de renforcer l’image d’invincibilité de l’armée française dans cette campagne éclair.
14 février 1814
Dernière bataille de la campagne des Six Jours, Vauchamps voit Napoléon infliger une sévère défaite aux forces de Blücher, qui avaient tenté d’attaquer l’arrière-garde française. Marmont résiste habilement jusqu’à l’arrivée de renforts menés par Napoléon. Une manœuvre d’encerclement, appuyée par une puissante charge de cavalerie, force les Prussiens à une retraite désastreuse.
18 février 1814
À Montereau, Napoléon affronte les troupes austro-wurtembergeoises du prince héritier de Wurtemberg. Après une progression difficile due à la résistance ennemie et à la lenteur de certaines troupes françaises, l’Empereur prend personnellement le commandement sur le terrain. Grâce à une attaque coordonnée sur les ponts de la Seine et de l’Yonne, il inflige une lourde défaite aux coalisés, qui abandonnent la ville.
27 février 1814
Macdonald tente de ralentir l’avance de la grande armée de Schwarzenberg à Bar-sur-Aube, mais les forces françaises, en infériorité numérique, sont repoussées après de violents combats. L’ennemi, bien organisé et disposant d’une supériorité écrasante en effectifs et en artillerie, reprend cette position stratégique, ouvrant la voie vers Troyes et la Seine.
7 mars 1814
La bataille de Craonne oppose les troupes françaises à l’armée de Blücher sur le plateau escarpé dominant l’Aisne. Napoléon, voulant interdire le passage des Alliés vers Laon, ordonne une attaque frontale difficile. Ney lance ses divisions contre les positions retranchées russes. Après de violents combats, les Français parviennent à prendre le plateau, forçant l’ennemi à reculer.
9–10 mars 1814
Napoléon tente de reprendre l’initiative face à l’armée de Blücher, solidement retranchée sur les hauteurs de Laon. Malgré une infériorité numérique majeure, il lance plusieurs attaques frontales appuyées par Ney et ses maréchaux. Les assauts échouent en raison du terrain défavorable, du manque de coordination et de la fatigue extrême de l’armée française. Laon reste aux mains des coalisés, marquant un échec stratégique majeur.
13 mars 1814
Napoléon, réagissant avec une rapidité fulgurante après sa retraite de Laon, surprend le corps allié du général Saint-Priest qui occupe Reims. En quelques heures, les forces françaises reprennent la ville après une attaque bien coordonnée. Saint-Priest est mortellement blessé, et son armée subit des pertes sévères. C’est l’une des dernières victoires éclatantes de Napoléon avant la chute de Paris.
20–21 mars 1814
Napoléon tente de surprendre l’armée de Schwarzenberg à Arcis-sur-Aube. Il engage le combat dans l’idée qu’il fait face à une simple arrière-garde, mais découvre trop tard qu’il affronte l’armée principale alliée. Le 20 mars, les Français repoussent les avant-postes ennemis, mais le lendemain, ils se retrouvent en forte infériorité numérique. Napoléon ordonne alors une retraite ordonnée, couverte par la cavalerie de Sébastiani.
26 mars 1814
Napoléon, espérant détourner les forces alliées de Paris, lance un raid vers l’est et affronte la cavalerie russe à Saint-Dizier. Le combat est vif mais limité, opposant principalement des unités montées. Napoléon tente de faire croire à une grande offensive vers l’est, mais les Alliés ne tombent pas dans le piège et marchent directement sur Paris. Le combat s’achève sans vainqueur décisif.
30–31 mars 1814
La bataille de Paris est l’ultime affrontement de la campagne de France. Tandis que Napoléon tente de harceler l’arrière des coalisés à Saint-Dizier, ceux-ci marchent directement sur la capitale. Marmont et Mortier, avec des forces largement inférieures, défendent la ville avec acharnement, notamment à Belleville, Montmartre et Romainville. Le 31 mars, Marmont capitule pour éviter la destruction de Paris.
16 juin 1815
La bataille de Ligny est le dernier triomphe militaire personnel de Napoléon. Il y écrase partiellement l’armée prussienne commandée par Blücher, qui tente de résister aux Français dans les villages de Ligny et Saint-Amand. La Garde impériale mène l’assaut décisif. Cependant, l’échec de Ney à vaincre Wellington à Quatre-Bras le même jour empêche Napoléon de détruire complètement les Prussiens.
16 juin 1815
Le même jour que Ligny, Ney tente de prendre le carrefour stratégique de Quatre-Bras afin d’empêcher la jonction entre les armées de Wellington et de Blücher. Malgré une attaque initiale vigoureuse et la prise temporaire du carrefour, Ney ne parvient pas à exploiter l’avantage et est repoussé par les renforts alliés. La bataille se termine sans vainqueur clair, mais les Alliés conservent la position.
18 juin 1815
La bataille de Waterloo, livrée le 18 juin 1815, marque la fin brutale des Cent-Jours et du destin impérial de Napoléon Bonaparte. Face aux forces anglo-alliées du duc de Wellington et à l’arrivée décisive de l’armée prussienne de Blücher, Napoléon engage sa dernière grande bataille avec l’espoir de détruire ses ennemis séparément. Le matin, le terrain détrempé ralentit les mouvements français, retardant l’assaut. L’affrontement débute par une attaque massive sur la ferme fortifiée d’Hougoumont, suivie de l’engagement du corps de D’Erlon contre le centre allié. L’intervention de la cavalerie britannique, menée par les Scots Greys et les Dragons lourds, repousse la tentative française. À partir de 15h, Ney, croyant à une retraite ennemie, lance plusieurs charges de cavalerie sans appui d’infanterie ni d’artillerie. Ces assauts successifs échouent contre les carrés alliés bien formés. L’arrivée progressive des troupes prussiennes sur le flanc droit français renverse l’équilibre. En fin de journée, Napoléon engage la Garde impériale dans un ultime effort pour percer le centre ennemi. La Garde est repoussée par les troupes britanniques et belgo-néerlandaises, provoquant la panique dans les rangs français. La débandade s’amplifie, et la défaite devient irréversible. Waterloo est plus qu’une défaite militaire : c’est un effondrement stratégique et psychologique.